Écouter, relier, transformer : les acteurs clés d’une santé mentale citoyenne
Penser la santé mentale comme un enjeu collectif
Les conseils locaux de santé mentale (CLSM) incarnent une transformation profonde de l’approche en santé mentale : territoriale, décloisonnée, inclusive. À la croisée des politiques publiques, des parcours de soins et des savoirs issus de l’expérience, les CLSM reposent sur un principe simple mais ambitieux : rassembler les acteurs concernés pour penser ensemble la santé mentale d’un territoire et œuvrer à son amélioration.
Parmi ces acteurs, quatre sont considérés comme incontournables : les élus locaux, les représentants de la psychiatrie, les personnes concernées par des troubles psychiques et les proches aidants. Leur présence conjointe dans les différentes instances du CLSM – comité de pilotage, groupes de travail, assemblée plénière – ne relève pas de la simple représentation symbolique. Elle conditionne la capacité du CLSM à remplir sa mission première : améliorer la santé mentale de l’ensemble de la population.
Mais comment favoriser concrètement leur participation ? Quels freins peuvent se poser, et quels leviers activer pour les surmonter ?

Les élus locaux : garants du portage politique et territorial
Pourquoi leur participation est essentielle ?
Sans volonté politique, pas de CLSM. La mise en place d’un conseil local de santé mentale repose d’abord sur un choix politique clair : celui d’un ou d’une élue qui acte la nécessité d’agir sur la santé mentale à l’échelle locale, et s’engage à porter cette dynamique dans la durée.
Créer un CLSM, c’est reconnaître la santé mentale comme une priorité du territoire. Cela suppose que des responsables politiques soient convaincus de son utilité, prêts à soutenir son développement et à assumer publiquement les priorités qu’il portera.
Une fois en place, leur rôle reste fondamental : c’est à eux ou à elles que revient la responsabilité d’acter les orientations stratégiques du CLSM, en lien avec leur vision du territoire. Car faire de la politique, c’est aussi cela : reconnaître les besoins, fixer un cap, mobiliser les ressources et créer les conditions pour que les actions puissent se déployer.
La santé mentale traverse de nombreux champs de compétences des collectivités : logement, urbanisme, petite enfance, éducation, vie associative, lien social… En l’intégrant dans leurs politiques publiques, les élus peuvent agir concrètement pour réduire les inégalités sociales de santé, soutenir les parcours de rétablissement, et contribuer à créer un environnement favorable au bien-être psychique de toutes et tous.
Leur engagement permet aussi :
-
De poser un regard transversal et stratégique sur les besoins de la population et leur évolution
-
De relayer les enjeux du CLSM auprès des autres échelons institutionnels (ARS, conseil départemental, intercommunalité, préfecture)
-
De mobiliser les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires au fonctionnement du CLSM
-
De sensibiliser et d’embarquer d’autres élus ou élues, en s’appuyant sur leur capacité à convaincre leurs pairs
-
Et surtout, de porter politiquement le CLSM, lui donnant la reconnaissance institutionnelle qui garantit sa légitimité, sa visibilité et son impact local
Enfin, les élus sont des figures identifiées du territoire. Leur engagement contribue à faire évoluer les représentations sur la santé mentale et à lutter contre la stigmatisation.
Pourquoi cela peut être compliqué ?
Même si 96 % des CLSM comptent un élu parmi leurs membres actifs, leur implication peut parfois être ponctuelle ou peu structurée. Plusieurs freins peuvent l’expliquer :
-
La santé mentale est encore souvent perçue comme un domaine technique ou médical, éloigné des champs d’action politique traditionnels
-
Certaines ou certains élus peuvent se sentir peu légitimes à intervenir, notamment dans les intercommunalités ou les communes, où la santé ne fait pas partie des compétences obligatoires
-
Les changements de mandature ou de délégation peuvent fragiliser la continuité du portage politique
-
Le CLSM peut apparaître comme un dispositif parmi d’autres, sans articulation claire avec les projets structurants du territoire
Quels leviers pour favoriser leur participation ?
-
Créer une culture commune autour de la santé mentale, en soulignant qu’il s’agit d’un enjeu transversal qui touche toutes les politiques locales
-
Montrer que le CLSM est un outil concret, utile pour structurer, amplifier ou coordonner des actions déjà engagées
-
Inscrire le CLSM dans les priorités du mandat, en l’articulant avec les dispositifs existants : contrat de ville, projet éducatif local, urbanisme, culture…
-
Associer plusieurs élus ou élues, au-delà de la seule personne en charge de la santé, pour garantir une approche intersectorielle et partagée
-
Valoriser leur rôle politique par des fonctions visibles (présidence, prise de parole, pilotage d’actions) et une reconnaissance dans les documents stratégiques du territoire
-
Organiser des temps d’échange entre élus pour faciliter le partage d’expérience entre pairs
-
Renforcer la coopération entre responsables politiques et acteurs de terrain, en créant des espaces de dialogue autour des besoins et projets locaux

La psychiatrie : actrice centrale du décloisonnement des soins
Pourquoi sa participation est essentielle
La participation de la psychiatrie publique au CLSM est indispensable. Elle garantit une articulation étroite entre les parcours de soins, les besoins des personnes concernées et les politiques territoriales. À travers leur engagement, les psychiatres, infirmières, psychologues ou cadres de santé contribuent à inscrire le soin dans une dynamique collective, ouverte, décloisonnée.
Les cheffes de pôle, médecins de secteur, cadres ou soignants des CMP ont une connaissance fine des réalités du terrain. Leur regard permet de mieux comprendre les freins à l’accès aux soins, les ruptures de parcours, les besoins de coordination ou les dynamiques locales déjà en place. Chacun et chacune joue un rôle pivot dans la mise en œuvre d’une approche territoriale de la santé mentale.
Leur engagement dans le CLSM permet aussi :
-
De contribuer à une meilleure coordination entre le soin, la prévention et le travail social
-
D’aligner les priorités de la psychiatrie publique avec les réalités vécues sur le territoire
-
De sortir d’une logique hospitalo-centrée en développant des liens durables avec les partenaires locaux
-
D’améliorer l’accès aux soins pour des publics éloignés ou non repérés par les structures de santé
-
De faire connaître le CLSM auprès des personnes suivies et de leurs proches
-
De contribuer à changer le regard porté sur la psychiatrie publique, en la rendant plus visible, plus lisible, et plus accessible
L’implication des équipes de psychiatrie dans les CLSM est également cohérente avec leur mission de service public. Promouvoir la prévention, soutenir le travail en réseau, contribuer à des parcours fluides et coordonnés font partie intégrante des attendus du secteur.
Pourquoi cela peut être compliqué ?
Même si les représentants de la psychiatrie sont présents dans la majorité des CLSM, leur implication active n’est pas toujours évidente. Plusieurs freins peuvent être rencontrés :
-
Une charge de travail élevée et des effectifs sous tension, qui laissent peu de place pour les démarches partenariales
-
Une culture encore marquée par le modèle hospitalo-centré, qui limite l’ouverture vers les dynamiques territoriales
-
Un manque de reconnaissance du temps consacré au CLSM, peu valorisé dans l’organisation interne des services
-
Une méconnaissance du rôle et des objectifs du CLSM, pouvant générer des doutes sur son utilité ou sa portée concrète
Quels leviers pour favoriser sa participation ?
-
Présenter le CLSM comme un outil complémentaire au soin, facilitant les parcours et améliorant les conditions d’accompagnement
-
Identifier une ou un référent stable au sein du secteur psychiatrique, reconnu dans l’équipe et capable de faire le lien avec les partenaires
-
Valoriser l’expertise de terrain des soignants et soignantes dans les groupes de travail et les actions locales
-
Associer les médecins et cadres à l’élaboration du diagnostic territorial et à la définition des priorités d’action
-
Faciliter leur participation logistique (réunions courtes, horaires compatibles, visibilité claire des objectifs)
-
Intégrer le CLSM dans les temps institutionnels de l’établissement, pour en faire un sujet légitime de discussion en réunion de service
-
Créer des temps d’interconnaissance entre professionnels de santé et autres acteurs du territoire
-
Favoriser la formation à la santé mentale communautaire et à la démocratie en santé, notamment pour les jeunes psychiatres ou les internes
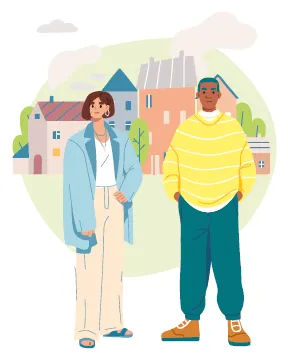
Les personnes concernées par des troubles psychiques : du vécu personnel à l’action collective
Pourquoi leur participation est essentielle ?
Les personnes concernées par des troubles psychiques ont une connaissance unique : celle de leur vécu. Ce savoir expérientiel permet d’éclairer différemment les enjeux du soin, du logement, du travail, de l’accès aux droits ou encore de la stigmatisation.
En participant au CLSM, les personnes concernées apportent un éclairage essentiel sur les priorités du territoire. Leur parole permet de mieux comprendre les réalités vécues, et d’élaborer des réponses collectives, au croisement des savoirs et des expériences.
Leur implication permet aussi :
-
De faire entendre les besoins spécifiques liés à l’expérience des troubles psychiques
-
De proposer des pistes concrètes pour améliorer les parcours de soins et de vie
-
De contribuer à la déstigmatisation, en rendant visibles des trajectoires de rétablissement, d’engagement et de renforcement du pouvoir d’agir individuel et collectif
-
De faire évoluer les pratiques professionnelles par le dialogue et la reconnaissance des savoirs croisés
-
De renforcer leur propre pouvoir d’agir, en se réappropriant une place citoyenne et politique dans la cité
Pourquoi cela peut être compliqué ?
Même si la participation des personnes concernées progresse dans les CLSM, elle reste parfois fragile ou marginale. Plusieurs freins peuvent l’expliquer :
-
Une méconnaissance du CLSM et de ses espaces de participation
-
Un manque de relais ou de collectifs pour faciliter l’identification et l’implication des personnes concernées
-
Des modalités de réunion peu accessibles (langage technique, lieux éloignés, horaires inadaptés)
-
Une stigmatisation intériorisée et le sentiment de ne pas être légitime ou de ne pas avoir sa place dans un espace institutionnel
-
L’absence de statut ou de rémunération pour encadrer leur participation
Quels leviers pour favoriser leur participation ?
-
Aller vers les personnes concernées, en s’appuyant sur les groupes d’entraide, les associations, les structures d’accompagnement ou les pairs aidants
-
Adapter les formats et supports : langage clair, supports visuels, réunions courtes et accueillantes
-
Permettre une diversité d’engagements : participation aux groupes de travail, co-animation, témoignages, etc.
-
Former et accompagner les personnes concernées, pour renforcer leur capacité à prendre part aux débats et aux projets
-
Reconnaître et soutenir l’engagement des personnes concernées par différentes formes de rétribution (rémunération, indemnisation, remboursement de frais), selon les modalités qui leur conviennent
-
Veiller à une représentation équilibrée et inclusive, en intégrant des profils variés, issus de parcours différents
-
Créer un climat de confiance, basé sur l’écoute, le respect et l’égalité entre les savoirs professionnels et expérientiels
-
Adapter les niveaux de participation aux envies, capacités et rythmes de chacun ou chacune

Les aidants : partenaires engagés de l’accompagnement et du changement
Pourquoi leur participation est essentielle ?
Les proches aidants jouent un rôle essentiel dans la vie des personnes concernées par des troubles psychiques. Qu’elles soient mères, sœurs, compagnes, ou qu’ils soient pères, frères, conjoints ou amis proches, ces personnes accompagnent au quotidien, souvent de manière invisible, dans les démarches de soins, les parcours de vie et les relations avec les institutions.
Leur expérience leur donne une double vision : celle des besoins de leurs proches, et celle des obstacles qu’ils rencontrent eux-mêmes. En participant au CLSM, les proches aidantes et aidants permettent de mieux comprendre les réalités de terrain, de faire émerger des besoins partagés, et de penser des réponses concrètes pour les familles.
Leur implication permet aussi :
-
De faire entendre des problématiques peu visibles, comme l’épuisement, l’isolement ou le besoin de répit
-
De contribuer à améliorer les relations entre les familles, les professionnels et les institutions
-
De soutenir la mise en place d’actions utiles à toutes et tous : espaces d’écoute, formations, ressources, groupes de soutien
-
De renforcer leur propre pouvoir d’agir, en sortant de l’isolement et en se sentant pleinement légitimes à contribuer aux décisions locales
Pourquoi cela peut être compliqué ?
Même si la majorité des CLSM intègrent des aidants (souvent via des associations comme l’Unafam), leur participation active reste parfois difficile à organiser. Plusieurs freins peuvent l’expliquer :
-
Une charge mentale importante et un manque de disponibilité pour s’impliquer dans des espaces collectifs
-
Un sentiment d’illégitimité à prendre la parole dans des lieux institutionnels
-
Des dispositifs parfois trop formels, peu compatibles avec la réalité du quotidien des aidantes et des aidants
-
Une reconnaissance encore insuffisante de leur rôle et de leur expertise, qui peut freiner leur légitimité perçue dans les espaces de concertation
-
Une représentation encore trop restreinte à quelques profils très engagés, sans toujours refléter la diversité des vécus et des parcours
Quels leviers pour favoriser leur participation ?
-
S’appuyer sur les associations de proches aidants présentes localement et aller à la rencontre des familles dans les lieux qu’elles fréquentent
-
Créer des espaces d’expression informels et accessibles, en parallèle des temps institutionnels
-
Valoriser leur expérience et leur rôle, en les intégrant dans les réflexions, les groupes de travail et les actions concrètes
-
Proposer des formes d’engagement souples, ponctuelles ou régulières, adaptées aux contraintes de temps
-
Favoriser des échanges à égalité avec les professionnels et les élues, en évitant les postures trop institutionnelles
-
Informer clairement sur le fonctionnement du CLSM et les différentes manières d’y contribuer
Construire une santé mentale citoyenne suppose de faire place à la diversité des regards, des expériences et des responsabilités. Élues, psychiatres, personnes concernées et proches aidants : chacune et chacun porte une part essentielle de la compréhension, du lien, de l’action.
Leur présence conjointe dans les CLSM n’est pas symbolique : elle est la condition d’un véritable travail collectif, à l’échelle des territoires. C’est dans cette alliance que se dessinent des réponses plus justes, plus proches, plus durables.
Donner à voir, relier, transformer : c’est ce que permettent les CLSM quand toutes les voix sont réunies autour de la table.